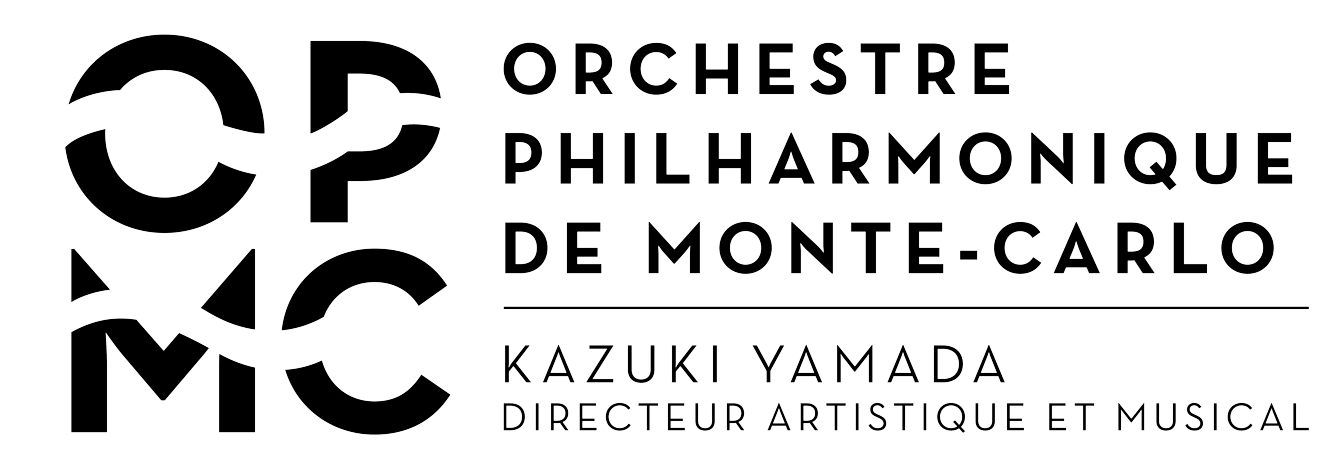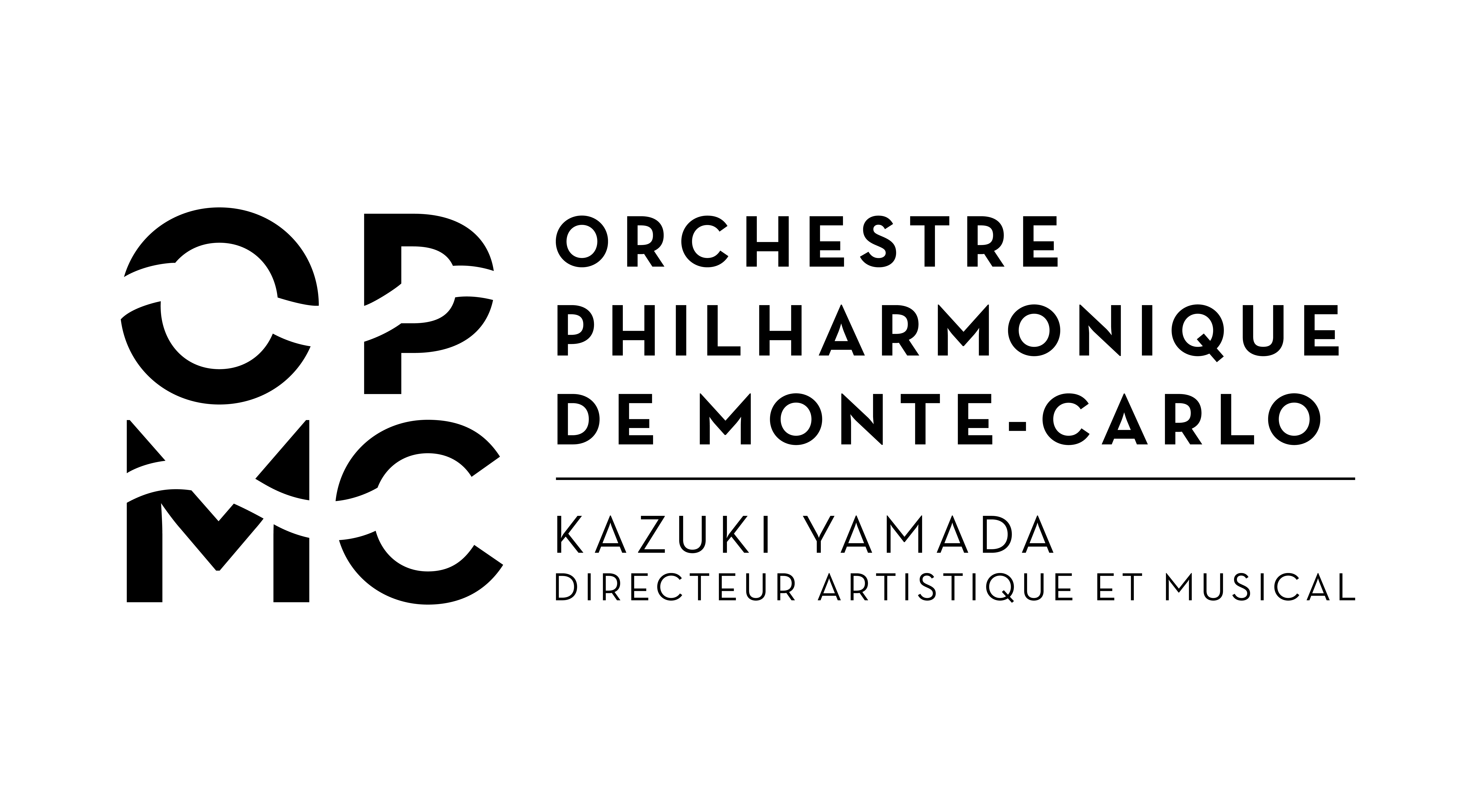– Andante – Allegro ma non troppo
– Andante con moto
– Scherzo : Allegro vivace – Trio
– Allegro vivace
Né à Vienne le 31 janvier 1797, mort dans cette même ville le 19 novembre 1828, Franz Schubert est le parfait symbole du voyageur romantique, ce marcheur incessant en quête du Paradis perdu, hanté par des amours refusées et l’ultime séparation. Chez lui, ces thèmes-clés ne cessent de jouer avec leur contraire, source d’une ambivalence inhérente qui forge sa singularité mais a pu engendrer de regrettables malentendus. Dans son « Histoire de la musique », Emile Vuillermoz a fort ingénument replacé Schubert dans une époque peu apte à se laisser saisir : « Schubert incarne, en effet, une des formes les plus respectables et des plus persuasives du romantisme. Le « mal du siècle » avait provoqué chez les artistes qui en furent atteints les réactions organiques les plus diverses […] Schubert n’était atteint que d’une hypertrophie du cœur dont aucun signe extérieur ne pouvait révéler l’existence. C’était un timide, cordial et casanier dont l’exaltation intérieure possédait le miraculeux privilège d’arracher secrètement au prosaïsme de la vie des trésors insoupçonnés de poésie, une abeille qui du suc des plus pauvres fleurs, savait tirer un miel délicieux. Et ce fut, en réalité, la manifestation la plus humaine et la plus durable de cet idéal artistique collectif engendré par une trop forte épidémie d’individualisme. » Et, cependant, on peut, dans sa globalité, considérer la personnalité de Schubert comme la première incarnation romantique stricto sensu, un être secret et solitaire au point de refuser la moindre entrave à sa création musicale (il fut sans profession fixe, ne fonda pas de famille, vivant chez un ami ou l’autre, etc.), un sacerdoce artistique aux allures de bohême. Il est souvent fait mention du « divin Mozart » et le remarquable film de Miloš Forman, au-delà de toute authenticité historique, se focalise sur la haine de Salieri accusant le Dieu des chrétiens d’avoir choisi ce petit homme facilement vulgaire comme « dépositaire » de Sa Parole, faite musique.
Autour de Schubert, l’anonyme et l’ignoré, point de jalousie mais, tout son œuvre est conversation avec l’au-delà, respirant l’indépendance et le détachement suprême de la réalité. Sa musique s’impose comme le couronnement de la vocalité et de la sacralité laïque. Son « dieu » à lui fut Beethoven, mais ce dieu il se garda bien de l’imiter, ce que confirment ses deux dernières symphonies dont la conception même s’oppose aux normes découlant de Beethoven…et, ce n’est pas la moindre des contradictions de Schubert ! En effet, si sa première symphonie fut achevée en 1813 (destinée à l’orchestre de l’école), c’est avec la Huitième Symphonie en si mineur (1822), malheureusement nommée «Inachevée » que la « symphonie schubertienne » voit véritablement le jour, incarnant un diptyque orchestral consciemment abouti et non en manque soudain d’inspiration.
En 1824, Schubert écrivait à son ami peintre Leopold Kupelwieser : « […] je me suis par contre livré à plusieurs essais dans le genre instrumental, ayant composé deux quatuors…et un octuor et je désire encore écrire un quartetto, car je veux avant tout me frayer ainsi la voie de la grande symphonie. ».
La « Grande symphonie » en ut majeur fut achevée en 1828, mais avait été conçue auparavant, en 1825-1826 selon la musicologie actuelle. Ses prémices se trouveraient dans l’énigmatique symphonie de Gmunden-Gastein (1) (1825) ainsi que dans les quatrième et sixième, la « tragique » en ut mineur et la « petite » en ut majeur (entre 1816 et février 1818). A l’instar de la Huitième, la structure classique, toujours aux bords de l’éclatement, s’oppose à toute classification. Schubert ne peut (veut ?) refreiner l’exploration maximale de ses idées musicales les plus intimes, exploitant, jusqu’à épuisement, leur vocalité et leur teneur.
Une fois de plus [il n’y eut qu’un concert public de ses œuvres du vivant de Schubert], Vienne, où la Symphonie devait être interprétée au printemps 1828, refusa son exécution alléguant sa longueur et sa trop grande difficulté ! En 1838, Schumann trouva chez le frère de Franz, Ferdinand, la partition de la « Grande symphonie en ut majeur » et la première exécution eut lieu, le 21 mars 1839, au Gewandhaus de Leipzig, sous la direction de Mendelssohn, suscitant un total enthousiasme. Schumann, dans son commentaire de l’œuvre, reconnaît la totale indépendance de la symphonie par rapport à Beethoven tout en la revendiquant pour le romantisme musical : « Je le dis d’emblée clairement : qui ne connaît pas cette symphonie connaît encore bien peu de choses de Schubert. […] En dehors de la maîtrise de la technique musicale de composition, il y a ici de la vie dans toutes les fibres, les plus fines nuances de coloris, de la signification en tout passage, la plus vive expression des détails et enfin, répandu sur le tout, un romantisme tel qu’on le connaît déjà en d’autres œuvres de Schubert. . Et les célestes longueurs de cette symphonie comme un gros roman en quatre volumes de Jean Paul (2)…il faudrait copier toute la symphonie pour donner une idée du caractère littéraire qui la traverse. Du second mouvement seulement, qui nous parle d’une voix si touchante, je ne veux pas prendre congé sans un mot. Il contient un passage où un cor semble lancer un appel de loin et qui me paraît être venu à nous d’une autre sphère. Ici tout semble être à l’écoute, comme si un hôte céleste se glissait furtivement dans l’orchestre. – La symphonie a produit parmi nous un effet que n’a atteint aucune autre depuis celles de Beethoven… ».
A l’image de Schumann qui, devant une trame mélodico-harmonique à la fois si dense et si intrinsèquement enchevêtrée, opte pour une « vision aérienne » de l’œuvre [une analyse complète serait pléthorique et une analyse partielle, aussi frustrante que mensongère], ne citons que les grands traits de chacun des quatre mouvements dont on peut déjà avancer que les deuxième et quatrième (Andante con moto et Allegro vivace) sont d’essence éminemment vocale.
L’Andante- Allegro ma non troppo qui ouvre la partition est introduit par un thème de cor à la tonalité hésitante. En émane un rythme pointé qui, se cristallisant, devient le motif principal de l’Allegro ma non troppo. Réapparaît le dessin du cor, clef de voûte du premier mouvement, que l’on pourrait qualifier d’épanouissement magistralement composé de ce thème ». Du « second mouvement », vitement évoqué ci-avant par Schumann, qui domine la symphonie, en marque le sommet et son accomplissement lyrique, disons qu’il s’édifie entièrement à partir d’un souple mouvement de marche (sept mesures de cordes) ininterrompue, préparant l’entrée du chant principal au hautbois. Avec une magistrale concision, le musicologue Stefan Kunze, présente cet Andante : « Le dispositif de rondo et la technique de variation spécifiquement schubertienne s’entrecroisent dans ce mouvement, auquel ses changements de substance confèrent une richesse inconcevable, et qui se résout enfin dans des accents suspendus en La mineur. »
Le Scherzo allegro vivace (Ut majeur) et son Trio (La majeur) se situent dans la lignée des précédents mouvements par son ampleur et la variété foisonnante des thèmes. Quant à l’Allegro vivace final en Ut majeur, ses quelques 1154 mesures en font un monument du répertoire (qu’il n’est question de « disséquer ») dont nous n’évoquerons qu’un détail, mais de quelle portée symbolique : dans l’essor en fanfare du final émerge schématiquement une réminiscence du début de l’Hymne à la joie qui conclut la Neuvième symphonie de Beethoven…
Voilà un chef-d’œuvre qui assume à l’extrême le sublime oxymore de Schumann : divines longueurs…
Alice BLOT
Nomenclature orchestrale :
4 flûtes – 4 hautbois – 4 clarinettes – 4 bassons – 4 cors – 2 trompettes – 3 trombones – timbales – cordes
Durée approximative : 49 minutes
Dernière exécution à Monte-Carlo : 10 avril 2009 – Auditorium Rainier III – Direction, Yakov KREIZBERG
(1) En février 1823, Schubert offre aux éditions B. Schött’s Söhne de Mayence quelques petites pièces et une symphonie accompagnée de ces mots : « …afin que vous connaissiez mes aspirations aux formes supérieures de l’art ».
(2) Jean Paul, de son vrai nom, Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825). Figure emblématique du romantisme allemand, cet écrivain connut un grand succès de son vivant et eut une influence considérable sur nombre de compositeurs tels Schumann ou Mahler.