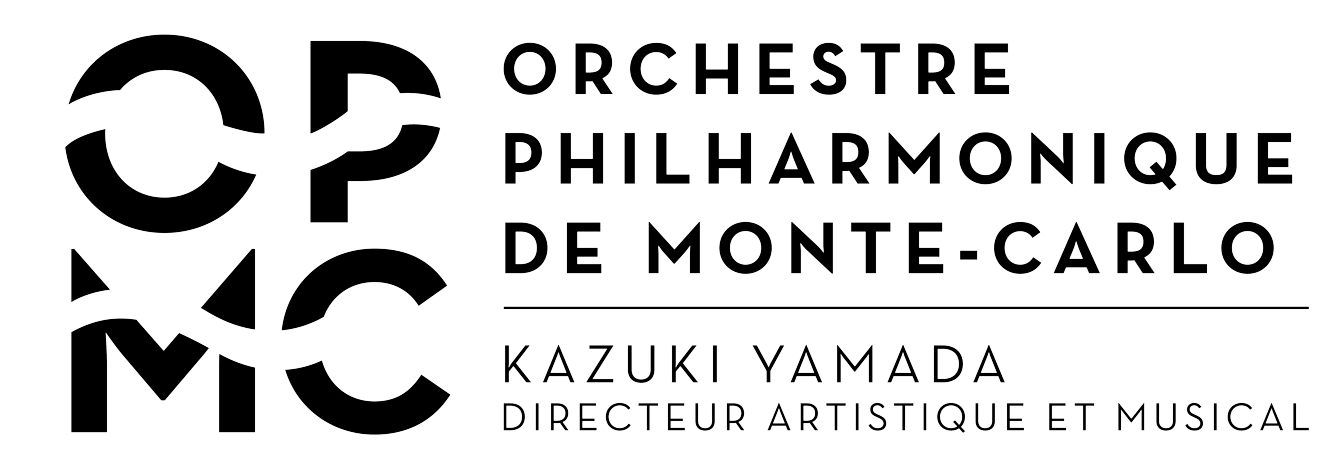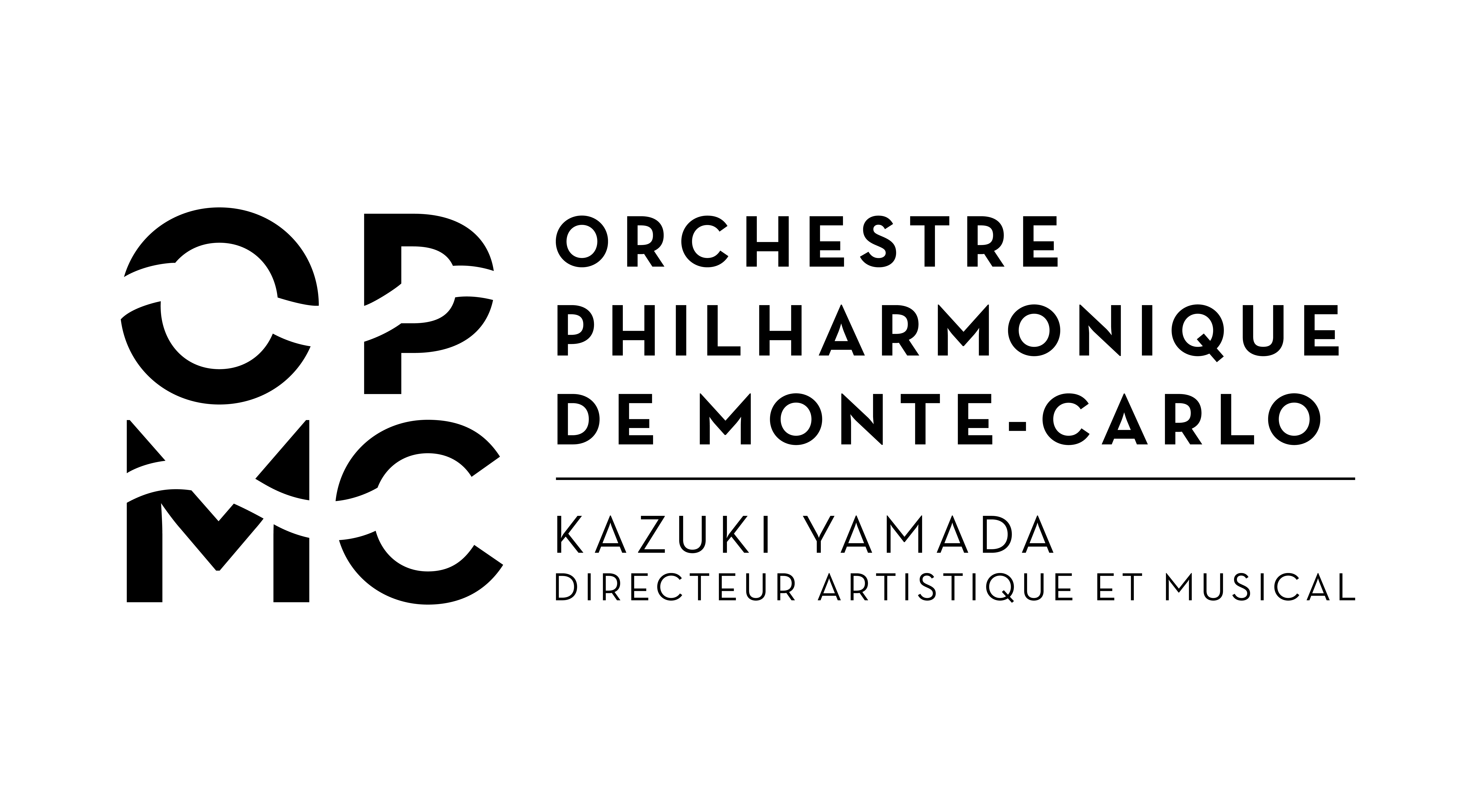« Frühling »
« September »
« Beim Schlafengehen »
« Im Abendrot »
Ce portrait de la Dame invisible, c’est celui qui servit de modèle à Richard Strauss pour composer entre mai et septembre 1948 la perle incomparable que sont les Vier Letzte Lieder, ultime chef-d’oeuvre du génie mélodique allemand.
Il lui fallait, comme une nécessité profondément ressentie, « composer un dernier Lied » avant d’abandonner, ce monde qui l’avait, dans ses tout derniers temps, si cruellement déchiré. Ce Lied c’est « Im Abendrot » (Dans la rougeur du couchant), sur des paroles de Joseph von Eichendorff. Mais trois autres le suivront, avec les poèmes de Hermann Hesse : « Frühling » (Printemps), « September » et « Beim Schlafengehen » (En s’endormant). Pourtant, le premier venu sera donné pour le dernier, sans doute parce qu’il s’achève sur la question « Ist dies etwas der Tod ? » : Serait-ce la Mort ?
Le temps de l’effroyable déchirement des « Métamorphoses » est passé. Déjà, entre, sinon dans l’oubli, du moins dans la contingence, l’effondrement du vieil Empire en même temps que celui du vieil homme. Strauss, enfin, connaît la sérénité.
Une semaine avant sa mort, recevant un visiteur à son chevet, il murmura « Grüss mir die Welt » : » Salue le monde pour moi ». Ce sont les mots mêmes d’Isolde à Bragäne au moment où elle choisit le philtre de la mort, ne sachant pas qu’elle va se tromper et boire celui qui la plongera dans le néant de l’Amour…
Cette même ambiguïté insoluble se retrouve dans les quatre derniers Lieder de Strauss.
Apparemment, l’apaisement, un recueillement presque heureux, une inébranlable sérénité dans les retrouvailles enchantées avec une Nature toute de douceur et de calme :
« Du lockest mich zart » (Tu m’attires doucement vers toi)
« In den Sterbenden Gartentraum » (Dans le rêve mourant de ce jardin)
« Um im Zauberkreis des Nacht Tief und Tausendfach zu leben » (Pour vivre plus intensément le monde magique de la nuit)
« O Weiter, Stiller Friede ! So tief im Abendrot » (Ô calme incommensurable du soir, si profond dans le couchant rouge !)
Mais qu’on lise mieux ces vers, et qu’on écoute les sons magiques qui les portent : cela n’a rien à voir avec le détachement chrétien, d’un monde imparfait qu’on va quitter pour l’éternel. Bien au contraire, cet ultime regard promené sur le jardin symbolique, ces derniers murmures enamourés frémissent de sensualité morbide. Strauss a beau évoquer les fleurs claires et riantes du printemps à venir, celles qui se balancent mollement dans ses Lieder sont des tubéreuses noires au parfum mortel. Le lent glissement du musicien dans la mort a les douceurs d’un mariage longtemps reculé ; sortant d’une de ses « absences » qui étaient le coma des derniers jours, et parlant de « Mort et Transfiguration », écrit soixante ans auparavant, il confiait à un ami : « Je ne m’étais pas trompé »…
Le musicien qui a prolongé jusqu’après la seconde guerre mondiale le grand siècle de la musique, c’est-à-dire le XIXème siècle, et par là, qualifié confusément d' »anachronique », compose au dernier instant un chant de mort 1900, où le raffinement extrême le dispute à la plus envoûtante morbidezza.
Et le 8 septembre 1949, à deux heures de l’après-midi, Richard Strauss épousait sa Dame invisible.
G. J
Nomenclature orchestrale : 3 flûtes (jouant aussi le piccolo), piccolo, 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, 3 bassons (le 3ème jouant aussi le contrebasson), 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, timbales, harpe, célesta, cordes
Durée approximative : 25 minutes environ
Dernière exécution à Monte-Carlo : 12 février 2016, Auditorium Rainier III – Jeffrey Tate direction, Emily Magee soprano