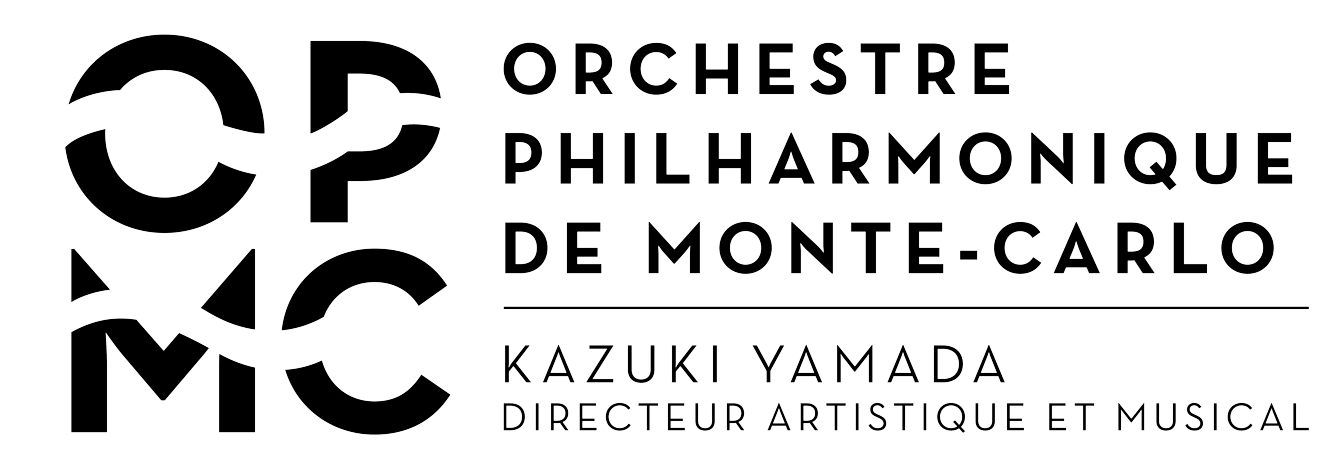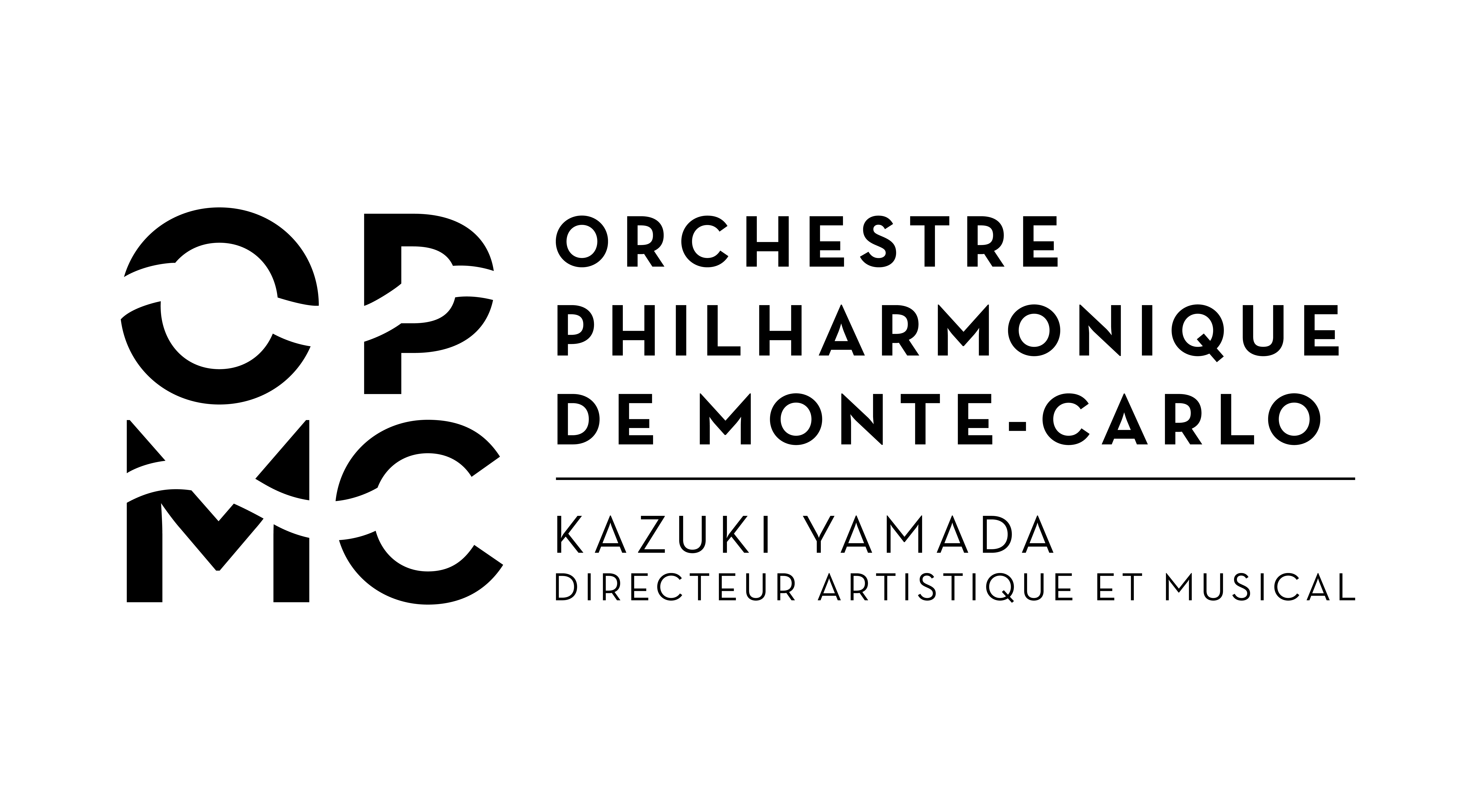Mai 1929 à l’Opéra de Paris : à l’affiche, les Ballets d’Ida Rubinstein, une chorégraphie de Bronislava Nijinska et des décors d’Alexandre Benois. A la tête de l’orchestre, Gustave Cloez. Juste récompense accordée à cette Valse de Ravel que Diaghilev, pourtant commanditaire de l’oeuvre, avait finalement refusée lors d’une première audition privée, neuf ans plus tôt, dans sa version pour deux pianos. Celui qui avait déjà privilégié Le Sacre du printemps de Stravinsky au détriment de Daphnis et Chloé, n’avait pas voulu de ce nouveau ballet. Poulenc se souvint longtemps de la façon dont le compositeur était parvenu à encaisser cette humiliation : “Ravel est arrivé très simplement, avec sa musique sous le bras et Diaghilev lui a dit : “eh bien, mon cher Ravel, quel bonheur d’entendre La Valse”… Et moi qui connaissais très bien Diaghilev à cette époque, j’avais vu le râtelier bouger, le monocle bouger, j’avais vu qu’il était embarrassé, qu’il n’aimait pas cela, qu’il allait dire “non”.
Quand Ravel eut terminé, Diaghilev lui a dit un mot que je crois très juste. Il a dit : “Ravel, c’est un chef-d’œuvre, mais ce n’est pas un ballet. C’est la peinture d’un ballet.” Mais ce qui est extraordinaire, c’est que Stravinsky n’a pas dit un mot ! Rien ! (…) Ravel a repris sa musique tout tranquillement, sans se soucier de ce qu’on pouvait en penser, et il est reparti bien calmement”. Calmement peut-être, mais ce fut-là la fin des rencontres avec Diaghilev, et peut-être même la fin de son amitié avec Stravinsky, avec lequel il n’allait plus entretenir que des rapports professionnels. Certes, l’histoire de La Valse fut des plus tourmentées. En 1906 déjà, Ravel voulait faire quelque chose sur la danse viennoise. Une sorte d’hommage à Johann Strauss, même si c’est de Schubert qu’il s’inspira cinq ans plus tard en écrivant ses Valses nobles et sentimentales. Mais la guerre dépouilla évidemment le projet de ses amusements innocents, au point d’inspirer un nouvel argument : “Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircies des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu : on distingue une immense salle peuplée d’une foule tournoyante. La scène s’éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au fortissimo. Une cour impériale vers 1855”. Où était passée la Vienne légère, fastueuse mais presque désinvolte de l’époque de François-Joseph ? Reculant dans le temps jusqu’à retrouver quelques troubles romantiques, Ravel n’en rendait son oeuvre que plus actuelle, pour en faire une “espèce d’apothéose de la valse viennoise à laquelle se mêle, dans mon esprit, l’impression d’un tournoiement fantastique et fatal”. Parfum de mort : La Valse conduisait son crescendo vers un point de non-retour, se précipitait elle-même vers sa propre dislocation, annoncée pianissimo dès les premières mesures par ses grondements rauques et une mesure à trois temps boiteuse, peinant à imposer sa danse. Il y a dans cette partition l’idée d’un affrontement entre mouvement et absence de mouvement, non pas dans l’installation de longues plages immobiles mais dans les ruptures, les périodes affreusement désordonnées, bouts de phrases s’élevant à peine pour retomber immédiatement, elle cette gamme de flûte, ascendante puis descendante, geste inutile, idée soudaine s’effaçant aussitôt. Sans oublier la façon dont les choses se juxtaposent, cette impression d’une unité perturbée, si surprenante lorsque l’on pense au rôle de la danse. Et Marcel Marnat remarquait dans sa passionnante monographie consacrée à Ravel : “l’auteur semble y accepter l’intrusion d’une certaine laideur. Il ne nous semble plus avoir affaire au musicien vétilleux dont le lyrisme même naissait d’un maître calcul”. Sans cesse recouverte par des bribes de timbres et de motifs, La Valse de Ravel se détournait de ses tourbillons charmants et se précipitait fiévreusement vers son auto destruction. Comme une société qui avait préféré fermer les yeux et, s’étant réfugiée dans des fêtes illusoires, n’avait pas regardé de face la catastrophe qui s’apprêtait à s’abattre sur elle…
François-Gildas Tual
Nomenclature orchestrale : 3 flûtes (la 3ème jouant aussi le piccolo), 3 hautbois (le 3ème jouant aussi le cor anglais), 2 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons, contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, timbales, percussions, 2 harpes, cordes
Durée approximative : 12 minutes
Dernière exécution à Monte-Carlo : 14 octobre 2010 – Auditorium Rainier III – Yan Pascal Tortelier direction