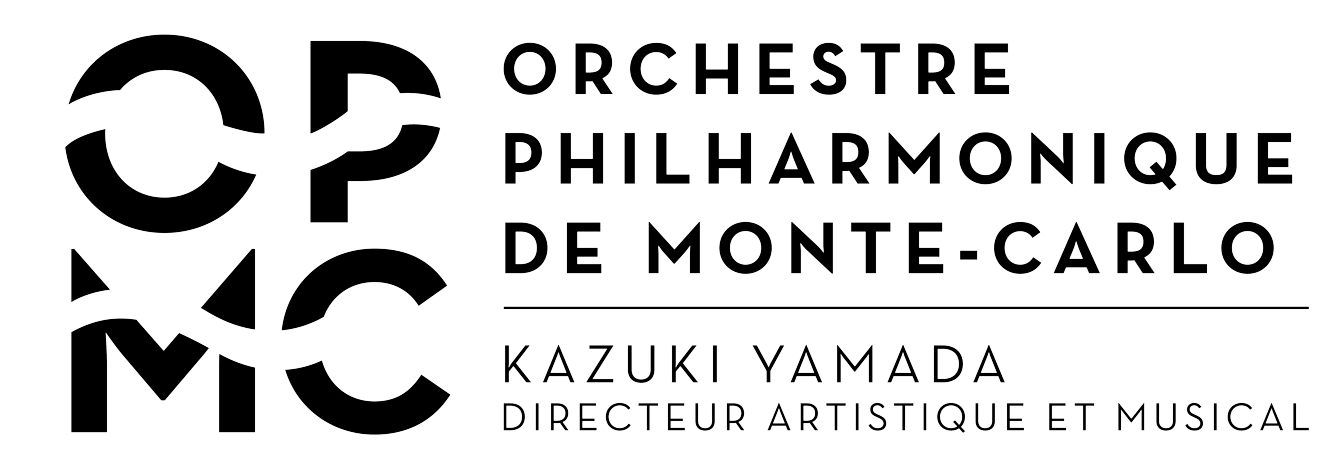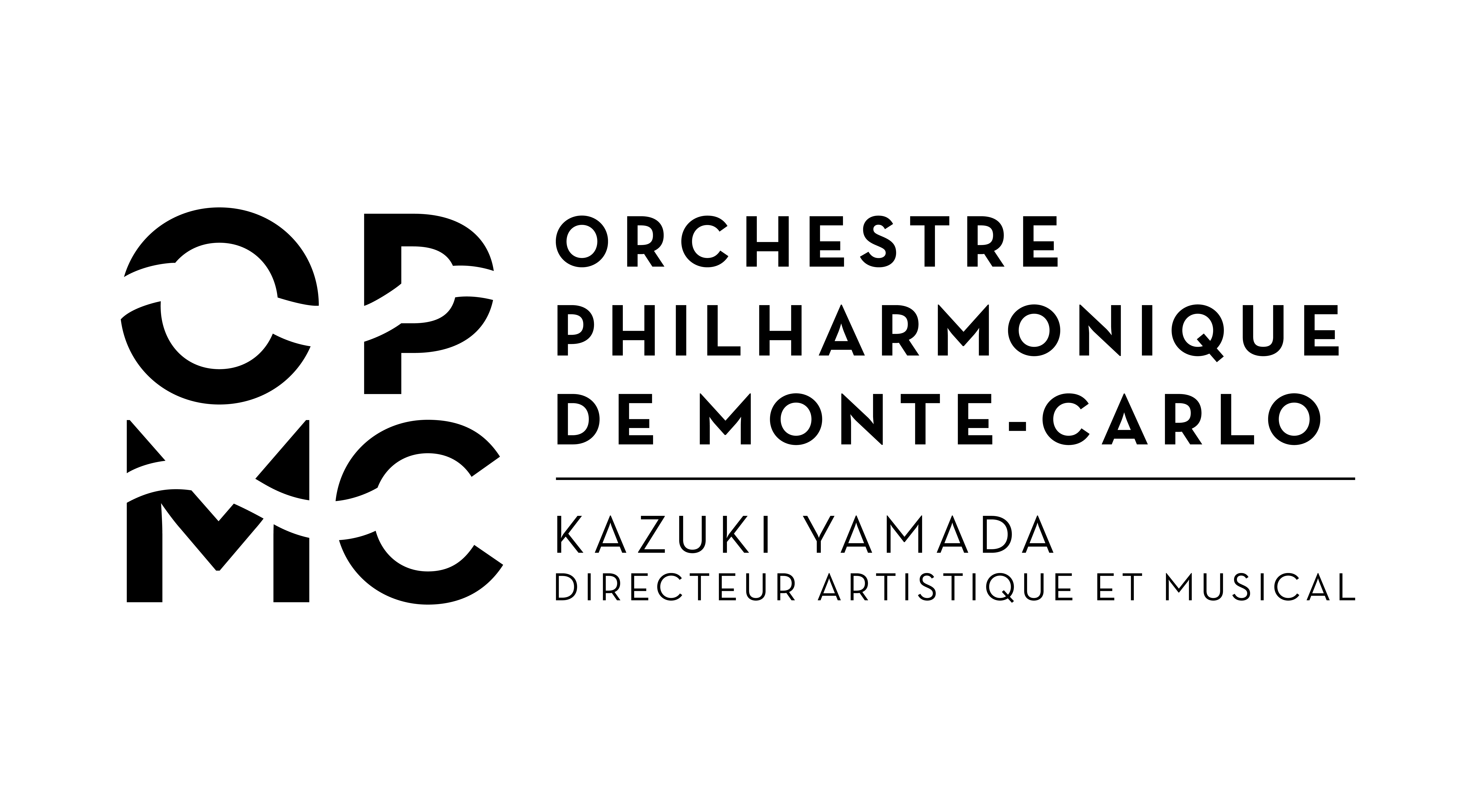Composition : 1912
Création : le 15 mai 1913 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris sous la direction de Pierre Monteux
Les années d’Avant-guerre, et plus particulièrement les années 1912-1913, comptent parmi les plus prolifiques de l’histoire de la musique. La version de ballet de Ma mère l’Oye et Daphnis et Chloé de Ravel, L’après-midi d’un Faune et Jeux de Debussy, Pierrot lunaire et Gurrelieder de Schoenberg, Le Sacre du printemps de Stravinsky, liste évidemment non exhaustive, témoignent de l’inventivité de l’époque. Mais la principale figure de la modernité de l’époque est sans doute Diaghilev, dont les Ballets russes provoquent au fil de leur spectacle toujours plus de surprise. A l’affiche de Jeux, Vaslav Nijinski pour la chorégraphie, Léon Bakst pour les décors et les costumes, Pierre Monteux pour la direction musicale. Sur scène, Nijinski lui-même, Tamara Karsavina et Ludmila Schollar. Mais la première collaboration de Debussy avec les Ballets – d’un premier projet sur Masques et Bergamasques, pas une note n’a été écrite, et L’Après-midi d’un faune, également interprété par Nijinski, reposait sur un Prélude symphonique inspiré par Mallarmé et conçu indépendamment de toute idée de ballet – ne se déroule pas comme prévu. Retenu par son travail sur Le Sacre du printemps, le chorégraphe semble incapable de tirer profit de la partition, et lors de la création, son improbable association de mouvements « modernes » – empruntés au tennis, au golf ou aux principes de Jaques-Dalcroze – et de pas de danse plus académiques n’obtient pas le succès escompté. Debussy lui-même, dans une lettre à son ami Robert Godet, ne cache pas ses doutes et son mécontentement : « Il paraît que cela s’appelle la “stylisation du geste”… C’est vilain ! C’est même Dalcrozien. » L’argument est tout aussi déconcertant, présenté comme une « apologie plastique de l’homme de 1913 » :
« Dans un parc au crépuscule, une balle de tennis s’est égarée ; un jeune homme, puis deux jeunes filles s’empressent à la rechercher. La lumière artificielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d’eux une lueur fantastique leur donne l’idée de jeux enfantins ; on se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison ; la nuit est tiède, le ciel baigné de douces clartés, on s’embrasse. Mais le charme est rompu par une autre balle de tennis jetée par on ne sait quelle main malicieuse. Surpris et effrayés, le jeune homme et les deux jeunes filles disparaissent dans les profondeurs du parc nocturne. »
Toujours est-il que Debussy ne tarde pas à réagir publiquement, faisant paraître dans Le Matin une longue critique de la chorégraphie de Nijinski : « Avant d’écrire un ballet, je ne savais pas ce que c’était qu’un chorégraphe. Maintenant, je le sais : c’est un monsieur très fort en arithmétique ; je ne suis pas encore très érudit, mais j’ai retenu pourtant quelques leçons… celle-ci par exemple : un, deux, trois, quatre, cinq ; un, deux, trois, quatre, cinq, six ; un, deux, trois ; un, deux, trois (un peu plus vite), et puis on fait le total. » Finalement, c’est au concert que la partition de « poème dansée » poursuit sa carrière. Et n’est-ce pas là en fait que se cachent les plus incroyables innovations. Quand Jacques-Emile Blanche a présenté à Debussy l’idée de Diaghilev, le compositeur aurait trouvé la suggestion idiote et non musicale, mais peut-être est-ce justement son insolente liberté et sa relative abstraction qui a inspiré la musique, dont la créativité est trop souvent négligée au profit du Sacre de Stravinsky. Dès le début, l’originalité s’affirme dans la combinaison de cors et de harpes sur un tapis sonore des altos divisés sur trois octaves à vide. Rien de plus intrigant que l’animation progressive de L4introduction par des figurations aux timbres extraordinairement diversifiés. Dans Pelléas et Mélisande et La Mer déjà, on pouvait constater une parcellisation comparable de l’écriture, conférant à l’orchestration le soin de relier les idées entre elles, jusqu’à en tirer la ligne essentielle. Mais l’éclatement de l’orchestre profite aussi à l’éclatement de la mélodie et de l’harmonie, menant le discours jusqu’aux portes de l’atonalité. Tout ici relève d’un statisme surprenant ; le mouvement est interne aux masses, et dès lors ne participe pas à une forme qui s’appuierait sur des retours ou des développements traditionnels. Non qu’il n’y ait pas de logique ; bien au contraire, le développement est poussé à l’extrême, et inspirera après guerre la génération postsérielle. Pierre Boulez bien sûr, mais aussi Jean Barraqué qui y devinera des « développements absents » et des « tranches d’oubli » : « c’est ainsi que l’œuvre échappe à l’effritement conceptuel, car la notion de discontinuité prend un nouveau sens ; il s’agit bien plus, sur le plan structurel, d’une ʺcontinuité alternativeʺ. » Pourtant, il serait dommage de n’envisager la partition sous le prisme de la nouveauté. Ici une esquisse de danse, là un soupir ou une brève phrase pleine de tendresse, ailleurs un sautillement gracieux, un sourire un peu moqueur, une locution presque triviale. Plus que sur scène, c’est dans la musique que triomphe la danse. Danse exquise de motifs qui sont autant de personnages se livrant à un surprenant théâtre. Et l’auditeur d’être le premier séduit par ces jeux juvéniles…
François-Gildas TUAL