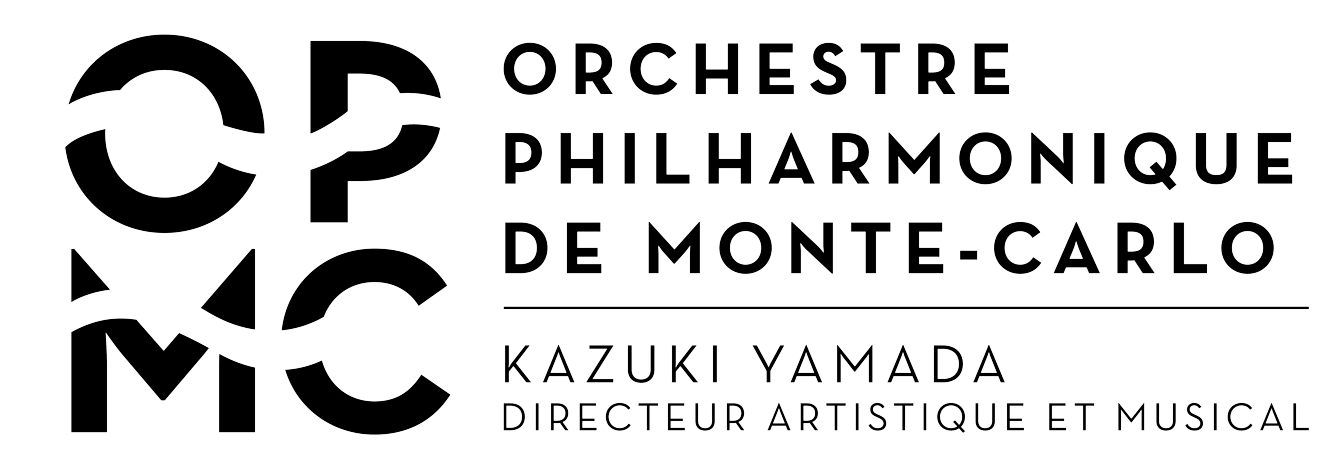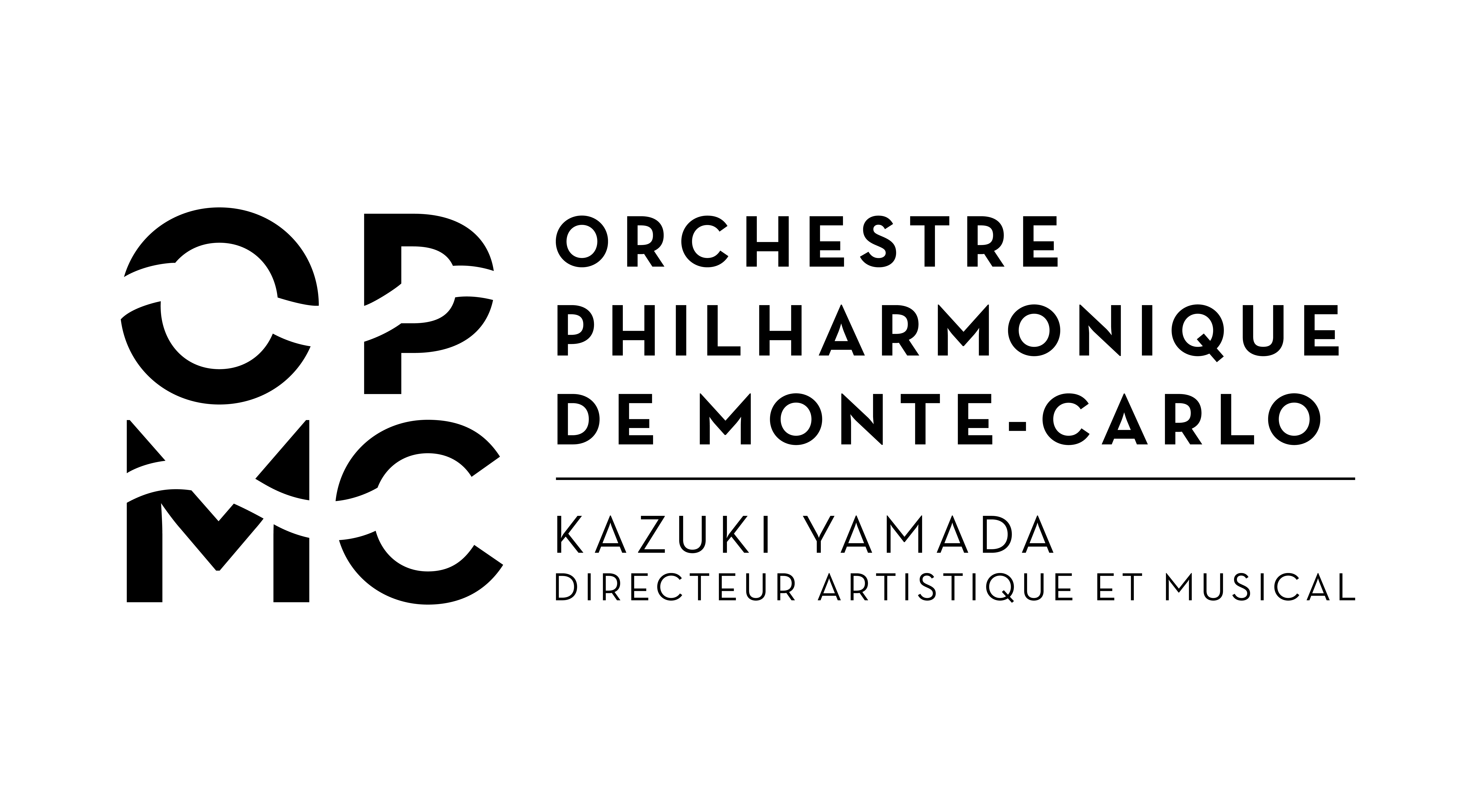Composé en 1904, et crée le 25 mai 1962 à Washington par l’Orchestre de Philadelphie placé sous la direction d’Eugene Ormandy.
« Révolutionnaire ? Certes, mais sans tapage et dans une incroyable discrétion. Radical ? Absolument, mais avec une sorte de naïveté hors du monde. Créant une musique qui s’éloignera peu à peu de la séduction immédiate pour arriver à la fascination d’une ascèse délibérée. La pureté – du langage -, de l’expression, de l’intention –, tel est le mot qui semble le mieux résumer le caractère d’une musique dépouillée, à l’évidence, mais riche de prolongements multiples. Pour moi, et pour bien d’autres musiciens, l’œuvre de Webern a été une pierre de touche essentielle, capitale, qui nous forçait, pour ainsi dire, à prendre parti, à nous révéler nous-même. » (Pierre Boulez, Webern dans le siècle).
En octobre 1999, Boulez redisait une fois encore combien l’élève de Schoenberg lui semblait tenir une place à part dans l’histoire de la musique du XXe siècle. Parce qu’il avait su se détourner des utilisations de la série ne consistant qu’à déterminer des hauteurs d’après quelques règles préétablies, Webern seul avait porté la «conscience d’une nouvelle dimension sonore». Et bien que Boulez confiât à Célestin Deliège en arriver à aimer chez Berg ce qu’il ne trouvait plus dans la perfection ascétique et dans le « dénuement le plus total » de Webern, jamais il ne se lassa de reprendre les œuvres de celui qui l’avait tant inspiré, demeurant sensible à des richesses plus profondément cachées et plus lentes à se donner. Devine-t-on toutefois, dans les œuvres de jeunesse de Webern, cette modernité sublime qui a renversé le cours du XXe siècle musical au moyen d’une écriture d’une délicatesse et discrétion rares ? Été 1904, Anton Webern n’a pas encore travaillé sous la direction d’Arnold Schoenberg quand il entreprend la composition d’un poème symphonique d’après un texte du poète, philosophe et politicien très libéral Bruno Wille. « Transportez-moi sur ces hauteurs escarpées où ne monta jamais la parole humaine », écrivait Wille en 1890 dans Ermite et camarade ; « mon âme blessée redoute le son de cette voix, et mes yeux roulent dans ma tête lorsqu’ils contemplent des hommes. ». « Le rocher et la nuée sont mes muettes consolations, et quand la tempête gronde autour de moi, j’entends des chants sublimes. »
Pour sa pièce, Webern a toutefois opté pour un recueil un peu plus récent, Révélations d’un genévrier, publiées en 1901 et dont il avait recopié certains extraits dans son journal. Là encore, le poète y chantait la nature, cette quiétude d’un soir d’été soudainement interrompue par un orage, et un chant d’alouette annonçant un apaisement aussi terrestre que céleste. En vacances dans le domaine familial du Preglhof en Carinthie, Webern trouve sans doute son inspiration dans la nature qui se découvre devant lui autant que dans les poèmes symphoniques de ses pères : Gustav Mahler et Richard Strauss. Bien sûr, le langage est résolument postromantique et tonal. Rien de vraiment nouveau dans ces tournures chromatiques qui se cherchent, ces longues plages harmoniques qui se métamorphosent au gré des changements de timbres, dans cette façon d’utiliser le crescendo ou dans les brusques oppositions de climat. Certains remarquent déjà les relais instrumentaux, la fragmentation des lignes tendant vers une parcellisation de la matière musicale.
Certes, le développement thématique n’est pas une fin en soi, et les mélodies sont suffisamment brèves pour se renouveler d’elles-mêmes. Mais ne faut-il pas moins chercher ce qui se prépare de modernité dans Im Sommerwind que ce qui en demeurera dans les chefs-d’œuvre de la maturité ? En 1904, la rencontre avec Schoenberg ne s’était pas faite, et le déclic n’avait pas eu lieu. Dans Sommerwind, l’économie de discours n’est en rien comparable avec les futurs aphorismes, et les gestes s’inscrivent pleinement dans la continuité historique.
François-Gildas TUAL
Nomenclature Orchestrale : 3 flûtes, 2 hautbois, cor anglais, 4 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons, 6 cors, 2 trompettes, timbales, percussions, 2 harpes, cordes
Durée approximative : 12 minutes
Dernière exécution à Monte-Carlo : 9 novembre 1984, Auditorium Rainier III – Aldo Ceccato direction