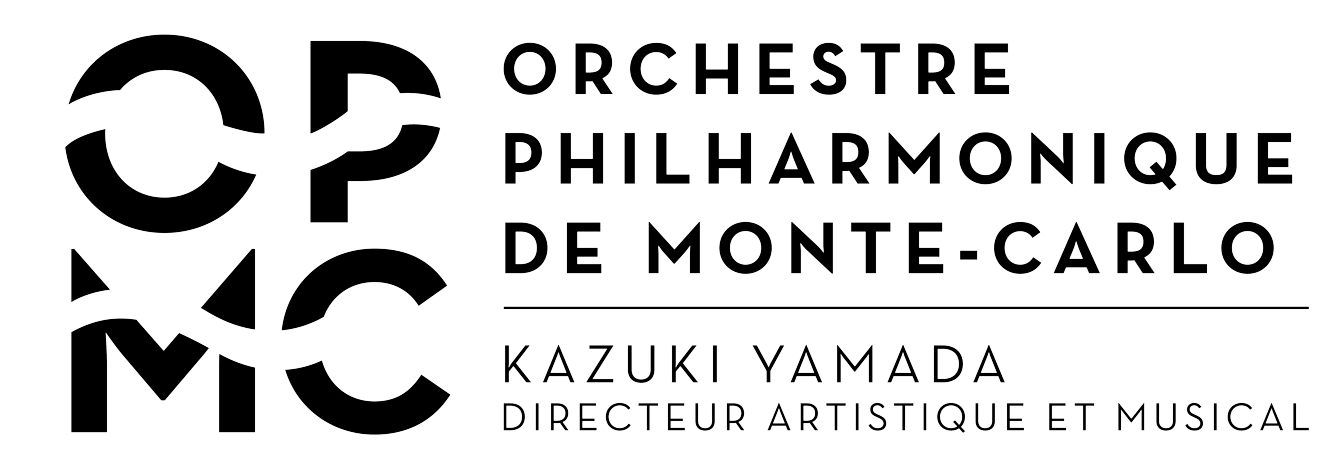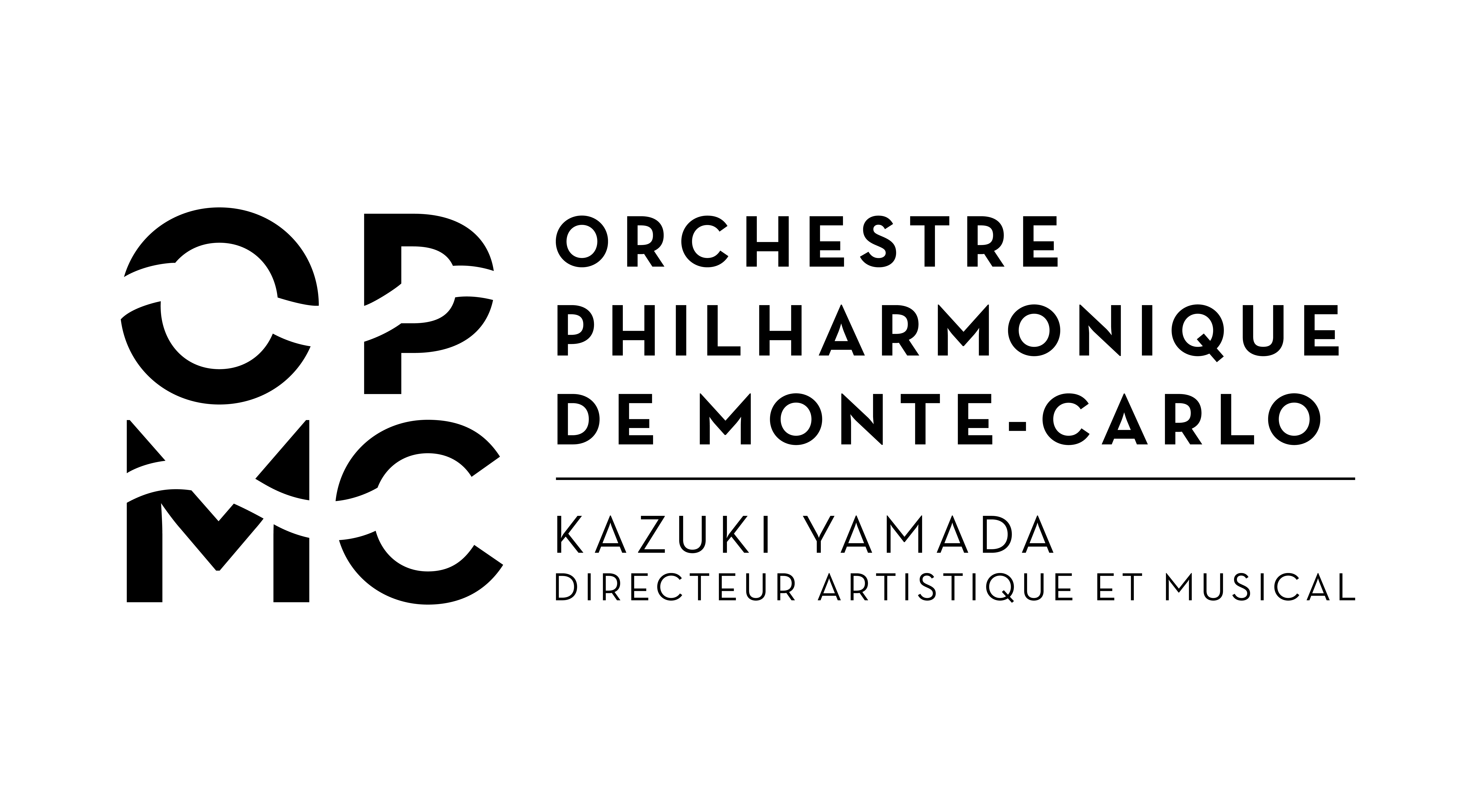(orchestration : Anton Dvořak)

11 Mai2025
Concert symphonique
GRANDE SAISON
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Lio KUOKMAN, Direction
Jorge Luis PRATS, Piano
BERNSTEIN, GERSHWIN, BARBER, RACHMANINOFF
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Lio KUOKMAN, Direction
Jorge Luis PRATS, Piano
BERNSTEIN, GERSHWIN, BARBER, RACHMANINOFF
18h00
Auditorium Rainier III, Monaco

18 Mai2025
Concert symphonique
GRANDE SAISON
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Giovanni ANTONINI, Direction
Isabelle FAUST, Violon
HAYDN, MOZART, BEETHOVEN
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Giovanni ANTONINI, Direction
Isabelle FAUST, Violon
HAYDN, MOZART, BEETHOVEN
CHANGEMENT DE PROGRAMME
DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES
DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES
15h00
Salle Garnier - Opéra de Monte-Carlo, Monaco

30 Mai2025
La Nouvelle Babylone
GRANDE SAISON
CINÉ-CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Frank STROBEL, Direction
MUSIQUE DE DMITRI CHOSTAKOVITCH
CINÉ-CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Frank STROBEL, Direction
MUSIQUE DE DMITRI CHOSTAKOVITCH
20h00
Salle Garnier - Opéra de Monte-Carlo, Monaco

5 Juin2025
Récital Hélène Grimaud
GRANDE SAISON
RÉCITAL DE PIANO
Saison 24/25
Hélène GRIMAUD, Piano
BEETHOVEN, BRAHMS, BACH/BUSONI
RÉCITAL DE PIANO
Saison 24/25
Hélène GRIMAUD, Piano
BEETHOVEN, BRAHMS, BACH/BUSONI
20h00
Auditorium Rainier III, Monaco

8 Juin2025
Concert symphonique
GRANDE SAISON
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
Anne-Sophie MUTTER, Violon
Pablo FERRÁNDEZ, Violoncelle
Kie ISHII, Flûte
TAKEMITSU, BRAHMS, SAINT-SAËNS
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
Anne-Sophie MUTTER, Violon
Pablo FERRÁNDEZ, Violoncelle
Kie ISHII, Flûte
TAKEMITSU, BRAHMS, SAINT-SAËNS
18h00
Auditorium Rainier III, Monaco

15 Juin2025
Hommage à Chostakovitch
GRANDE SAISON
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Juraj VALČUHA, Direction
Andreï KOROBEINIKOV, Piano
GLAZOUNOV, CHOSTAKOVITCH, STRAUSS
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Juraj VALČUHA, Direction
Andreï KOROBEINIKOV, Piano
GLAZOUNOV, CHOSTAKOVITCH, STRAUSS
18h00
Auditorium Rainier III, Monaco

22 Juin2025
Concert symphonique
GRANDE SAISON
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Tomáš NETOPIL, Direction
Maria João PIRES, Piano
Lucas & Arthur JUSSEN, Pianos
SCHUBERT, MOZART, SUK
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Tomáš NETOPIL, Direction
Maria João PIRES, Piano
Lucas & Arthur JUSSEN, Pianos
SCHUBERT, MOZART, SUK
18h00
Auditorium Rainier III, Monaco

10 Juin2025
Hommage à Ravel
HAPPY HOUR MUSICAL
Saison 24/25
Musiciens de l'OPMC
RAMEAU, JADIN, RAVEL
Saison 24/25
Musiciens de l'OPMC
RAMEAU, JADIN, RAVEL
18h30
Maison de France, Monaco

14 Mai2025
Pierre et le loup & L’Histoire du Pope et de son serviteur Balda
JEUNE PUBLIC
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Philippe BÉRAN, Direction
Joan MOMPART, Comédien
Marina SOSNINA, Artiste sur sable
CHOSTAKOVITCH, PROKOFIEV
CONCERT SYMPHONIQUE
Saison 24/25
Philippe BÉRAN, Direction
Joan MOMPART, Comédien
Marina SOSNINA, Artiste sur sable
CHOSTAKOVITCH, PROKOFIEV
15h00
Auditorium Rainier III, Monaco

10 Juil2025
L. Foster & D. Lozakovich
CONCERTS AU PALAIS PRINCIER
Saison 24/25
Lawrence FOSTER, Direction
Daniel LOZAKOVICH, Violon
BEETHOVEN, WIENIAWSKI, KODÁLY
Saison 24/25
Lawrence FOSTER, Direction
Daniel LOZAKOVICH, Violon
BEETHOVEN, WIENIAWSKI, KODÁLY
21h30
Cour d'Honneur du Palais Princier, Monaco

20 Juil2025
K. Yamada & L. & A. JUSSEN
CONCERTS AU PALAIS PRINCIER
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
Lucas & Arthur JUSSEN, Pianos
WEBER, MENDELSSOHN, BRAHMS
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
Lucas & Arthur JUSSEN, Pianos
WEBER, MENDELSSOHN, BRAHMS
21h30
Cour d'Honneur du Palais Princier, Monaco

27 Juil2025
Paul McCartney’s Liverpool Oratorio
CONCERT EXCEPTIONNEL
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
CBSO Chorus
Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III
Liverpool Oratorio de Paul McCARTNEY & Carl DAVIS
Saison 24/25
Kazuki YAMADA, Direction
CBSO Chorus
Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III
Liverpool Oratorio de Paul McCARTNEY & Carl DAVIS
21h30
Grimaldi Forum (Salle des Princes), Monaco

31 Juil2025
C. Dutoit & D. Fray
CONCERTS AU PALAIS PRINCIER
Saison 24/25
Charles DUTOIT, Direction
David FRAY, Piano
BEETHOVEN, RAVEL, RESPIGHI
Saison 24/25
Charles DUTOIT, Direction
David FRAY, Piano
BEETHOVEN, RAVEL, RESPIGHI
21h30
Cour d'Honneur du Palais Princier, Monaco

3 Août2025
T. Lu & G. Osokins
CONCERTS AU PALAIS PRINCIER
Saison 24/25
Tianyi LU, Direction
Georgijs OSOKINS, Piano
BEETHOVEN, PROKOFIEV
Saison 24/25
Tianyi LU, Direction
Georgijs OSOKINS, Piano
BEETHOVEN, PROKOFIEV
21h30
Cour d'Honneur du Palais Princier, Monaco

7 Août2025
E. Tjeknavorian & S. Khachatryan
CONCERTS AU PALAIS PRINCIER
Saison 24/25
Emmanuel TJEKNAVORIAN, Direction
Sergey KHACHATRYAN, Violon
LISZT, BRUCH, R. STRAUSS, J. STRAUSS
Saison 24/25
Emmanuel TJEKNAVORIAN, Direction
Sergey KHACHATRYAN, Violon
LISZT, BRUCH, R. STRAUSS, J. STRAUSS
21h30
Cour d'Honneur du Palais Princier, Monaco
/
{"playlist":[{"title":"De Sabata – Juventus, po\u00e8me symphonique","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Juventus-poeme-symphonique-DE_SABATA.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/De_Sabata.jpg","duration":"2:59","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Stravinsky – Le sacre du printemps","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Stravinsky-Le-sacre-du-printemps-extrait-OPMC-Classics-001.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000019884828-1yjx7a-t500x500.jpg","duration":"0:46","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Stravinsky – l’Oiseau de feu (extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Stravinsky-lOiseau-de-feu-extrait-OPMC-Classics-001.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000019884828-1yjx7a-t500x500.jpg","duration":"0:43","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Stravinsky – Petrouchka (extrait 2)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Stravinsky-Petrouchka-extrait-2-OPMC-Classics-001.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000019884828-1yjx7a-t500x500.jpg","duration":"0:42","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Stravinsky – Petrouchka (extrait 1)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Stravinsky-Petrouchka-extrait-1-OPMC-Classics-001.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000019884828-1yjx7a-t500x500.jpg","duration":"0:47","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Rimsky-Korasakov – She\u0301he\u0301razade (Extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Rimsky-Korasakov-She\u0301he\u0301razade-Extrait-OPMC-Classics-003.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041015185-ub70lo-t500x500.jpg","duration":"0:52","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Ravel – Daphnis et Chloe\u0301 (Extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Ravel-Daphnis-et-Chloe\u0301-Extrait-OPMC-Classics-002.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041015673-4j1wni-t500x500.jpg","duration":"0:30","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Debussy – Pre\u0301lude a\u0300 lapre\u0300s-midi dun faune (extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Debussy-Pre\u0301lude-a\u0300-lapre\u0300s-midi-dun-faune-extrait-OPMC-Classics-002.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041015673-4j1wni-t500x500.jpg","duration":"0:39","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Moussorgsky – Une nuit sur le Mont Chauve (extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Moussorgsky-Une-nuit-sur-le-Mont-Chauve-extrait-OPMC-Classics-003.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041015185-ub70lo-t500x500.jpg","duration":"0:53","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Borodine – Danses Polovtsiennes (extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Borodine-Danses-Polovtsiennes-extrait-OPMC-Classics-003.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041015185-ub70lo-t500x500.jpg","duration":"0:48","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Chostakovitch – Symphonie n\u00b011 du 4e\u0300me mvt Le Tocsin (extrait)","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Chostakovitch-Symphonie-n\u00b011-extrait-du-4e\u0300me-mouvement-Le-Tocsin-OPMC-Classics-005.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041018474-3ovqdp-t500x500.jpg","duration":"1:12","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"Mahler – 5e\u0300me symphonie extrait du 1er mouvement","artist_name":"OPMC","audio_file":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Mahler-5e\u0300me-symphonie-extrait-du-1er-mouvement-OPMC-Classics-006.mp3","poster_image":"https:\/\/opmc.mc\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/artworks-000041018637-ygbw3z-t500x500.jpg","duration":"1:10","playlistid":"playlistid-1"}]}